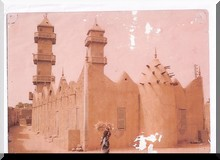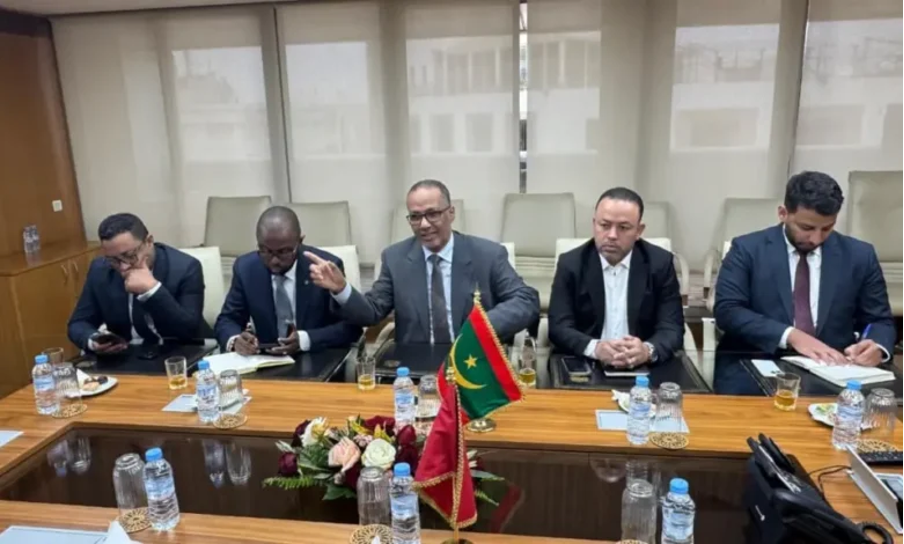La Mauritanie, notre terre, est le témoin d’une histoire millénaire marquée par des luttes, des croyances et des résistances de divers peuples. En ce moment crucial de dialogue national, il est essentiel de revisiter notre mémoire collective, non pas pour engendrer des divisions, mais pour créer des liens d’unité.
L’État moderne doit reconnaître l’importance des royaumes anciens, des émirats, des marabouts, ainsi que des hommes et des femmes qui ont contribué à bâtir notre nation, bien avant l’ère coloniale. L’histoire n’est pas simplement un récit ; c’est un puissant levier moral, politique et identitaire.
Des figures emblématiques de la résistance, telles que Bakar Ould Soueid Amed, Abdoul Bocar Kane à Kaédi, Sid’Ahmed Aïda dans l’Adrar, Ould Abdouka au Hodh, et Cheikh Malainine au nord, ainsi que Ould Meinouh Sidi Moulaye Zein et Sid Ahmed Bneijara au Tagant, sans oublier Mohamed Lemine Dramé et El Hadj Mahmoud Bâ de Djeol, ont sacrifié leur vie pour la liberté. Leur lutte contre la domination coloniale a été massive, déterminée et diverse. Des croyants, des chefs de guerre, des intellectuels et des marabouts ont défié la France, animés par leur foi et leur soif de liberté.
À Kaédi, le 15 février 1930, 53 résistants – principalement des talibés de Cheikhna Hamahoullah – ont perdu la vie lors d’une confrontation orchestrée par les autorités coloniales pour briser une cohésion spirituelle trop puissante. De nombreuses autres personnes ont été déportées à travers l’empire colonial français : en Côte d’Ivoire, au Bénin, au Mali, en Guinée, au Burkina Faso, et même à Nouakchott, Aleg, Atar et Moudjeria. Certains ont perdu la vie dans ces lieux de déportation, tandis que d’autres ont été condamnés à des travaux forcés.
Dans un contexte de tensions, de divisions identitaires et d’incertitudes économiques, il est primordial de se concentrer sur ce qui nous unit plutôt que sur ce qui nous sépare. La Mauritanie, carrefour entre l’Afrique noire et le monde arabe, possède une histoire riche et complexe, forgée par des luttes communes, des échanges séculaires et une culture plurielle qui a su résister aux épreuves du temps. Cette histoire n’est pas qu’une simple chronique du passé ; elle est le socle de notre avenir, à réhabiliter et partager comme une source de fierté collective.
Les grandes figures de notre passé, qu’elles proviennent des Almoravides, des résistants à la colonisation, des bâtisseurs d’indépendance ou des pionniers de la République, doivent occuper une place centrale dans notre récit national. Leurs combats, leurs rêves et leurs sacrifices pour un pays uni, libre et digne sont une boussole pour les générations actuelles, souvent tentées par le repli, la méfiance ou l’oubli. Le vivre-ensemble mauritanien repose sur une mémoire commune qu’il nous revient de raviver, de transmettre et de célébrer. Les écoles, les médias, les associations, les mosquées et même les familles ont un rôle crucial à jouer dans cette réconciliation avec notre patrimoine.
La solidarité autour de notre histoire ne doit pas se traduire par l’uniformité ni par le rejet de nos diversités ethniques, culturelles ou linguistiques. Au contraire, il s’agit de reconnaître chaque fragment du passé comme une partie intégrante de notre destin collectif. Haratines, Peuls, Soninkés, Wolofs, Maures… chacun a contribué à forger cette épopée mauritanienne. Aujourd’hui, nous avons besoin de cette union sincère, non pas imposée par des politiques, mais portée par les citoyens conscients que l’avenir d’un peuple se construit à partir de son histoire.
Il ne s’agit pas d’idéaliser le passé, mais de s’en inspirer pour renforcer nos liens, guérir nos blessures et projeter une vision nationale inclusive et forte. Nos différences ne doivent pas être un prétexte à la division, mais un levier pour une unité authentique. Aucune nation ne peut prospérer sans mémoire, et aucun peuple ne peut avancer sans solidarité.
Il est temps pour les Mauritaniens, jeunes et moins jeunes, de réinvestir leur histoire avec fierté, d’en faire un outil d’émancipation et de paix, un fondement pour la justice, le progrès et l’unité. C’est en nous reconnaissant dans une histoire partagée que se construit la véritable citoyenneté. Ensemble, unis autour de notre passé, nous bâtirons l’avenir.
Mohamed BNEIJARA