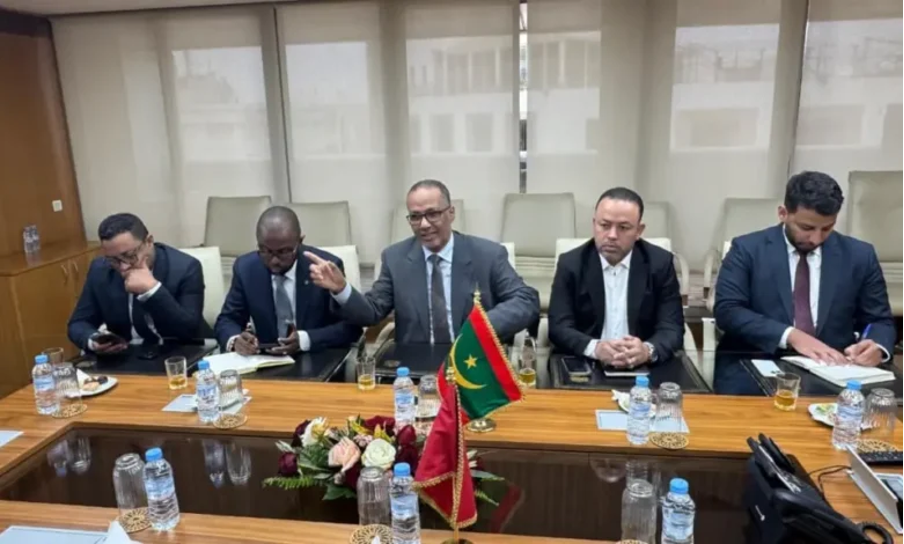La récente décision du ministère de l’Équipement d’interdire la circulation des moyens de transport de passagers après une certaine heure suscite une vive controverse. Cette mesure, prise sans consultation préalable ni plan d’accompagnement digne de ce nom, est non seulement juridiquement discutable, mais elle constitue aussi une atteinte grave aux droits fondamentaux des citoyens, notamment à leur liberté de circulation, pourtant garantie par la Constitution de la République Islamique de Mauritanie. Elle reflète une gestion simpliste d’un problème complexe, celui de l’insécurité routière, qui nécessite des solutions structurelles, concertées et respectueuses des droits humains.
Dans les faits, cette mesure expose des familles entières, souvent accompagnées d’enfants en bas âge ou de personnes malades, à des situations inhumaines et dangereuses. Être contraint de passer la nuit à un poste de contrôle, sans abri, sans accès à des sanitaires, à l’eau potable ou à une assistance minimale, constitue un traitement indigne. En période d’hivernage, ces conditions deviennent encore plus critiques : les risques sanitaires se multiplient avec la recrudescence du paludisme, des maladies diarrhéiques, et la menace de morsures de serpents ou d’autres animaux venimeux. Ce n’est ni acceptable sur le plan social, ni moralement défendable, encore moins conforme aux engagements internationaux de la Mauritanie en matière de droits humains.
Sur le plan juridique, il est important de rappeler que la liberté de circulation des personnes à l’intérieur du territoire est un droit fondamental protégé par la Constitution, et reconnu par des instruments juridiques internationaux que la Mauritanie a ratifiés, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Une telle restriction, pour être licite, doit répondre à des critères stricts : elle doit être fondée sur une base légale explicite, répondre à un objectif légitime, être nécessaire à cet objectif et proportionnée aux risques identifiés. Or, rien ne permet aujourd’hui de considérer que cette interdiction de circuler la nuit réponde à ces exigences. Aucune évaluation publique des risques n’a été rendue accessible, aucun cadre légal n’a été invoqué, et surtout, aucune alternative sûre n’a été mise en place pour les voyageurs affectés.
L’argument sécuritaire souvent avancé ne peut justifier à lui seul une atteinte aussi grave aux libertés publiques. Ce type de logique a souvent servi à masquer l’incapacité de certaines autorités à remplir leurs responsabilités premières, notamment l’aménagement et l’entretien des routes, le contrôle technique des véhicules, et la régulation efficace du secteur du transport. Au lieu d’imposer des interdictions générales, le ministère de l’Équipement et l’Autorité de régulation des transports devraient concentrer leurs efforts sur les véritables causes de l’insécurité routière. Il s’agit en priorité d’équiper les routes d’un balisage adapté et fonctionnel, de renforcer les contrôles techniques des véhicules en circulation — notamment l’état des phares, des freins et des pneus — et d’interdire la circulation de véhicules vétustes ou défectueux. Par ailleurs, une formation rigoureuse des chauffeurs, couplée à des campagnes continues de sensibilisation sur la sécurité routière, serait bien plus efficace pour prévenir les accidents.
Cette approche centrée uniquement sur l’interdiction n’est pas seulement inefficace, elle est également contre-productive. Elle alimente un sentiment d’injustice, accroît la méfiance des citoyens envers les institutions, et expose les populations à des risques encore plus graves que ceux que la mesure prétend prévenir. Les citoyens ne devraient pas être les victimes des défaillances de l’État. Il est inadmissible que, faute d’infrastructures, de planification ou de moyens, ce soient les voyageurs — souvent les plus vulnérables — qui paient le prix de l’inaction ou du manque de vision des autorités.
En somme, cette mesure restrictive ne répond ni aux exigences de droit, ni aux impératifs d’efficacité, ni aux obligations morales de l’État envers ses citoyens. Elle doit être suspendue sans délai et remplacée par une politique de sécurité routière cohérente, fondée sur la prévention, l’investissement dans les infrastructures, le respect des normes techniques, et surtout, sur le respect des droits humains. L’État doit assumer pleinement sa mission de garant de la sécurité publique, sans pour autant porter atteinte aux libertés constitutionnelles qui fondent notre République.
Mohamed BNEIJARA