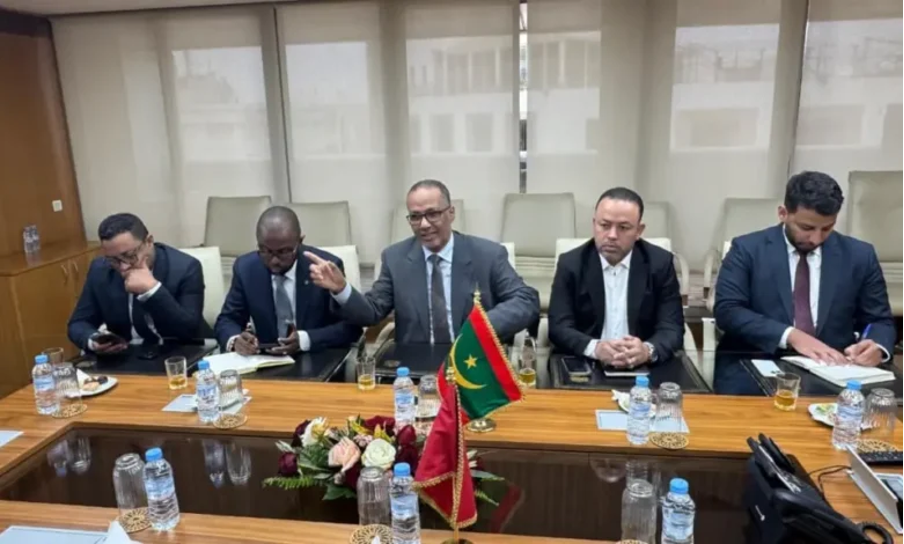Dans les vastes plaines du sud mauritanien, entre le Gorgol, le Guidimakha et le Brakna, les Peulhs – également appelés Halpulaar – ont joué un rôle central dans la résistance contre l’expansion coloniale française à partir de la fin du XIXe siècle. Méconnue ou marginalisée dans les récits officiels, leur résistance mérite aujourd’hui d’être réintégrée pleinement dans la mémoire nationale.
Les Peulhs, traditionnellement pasteurs, commerçants et agriculteurs, vivaient dans des sociétés structurées autour de chefferies locales, de marabouts influents et de réseaux de solidarité transfrontaliers. Dès l’arrivée des troupes coloniales françaises, des formes de résistance armée, religieuse et symbolique ont émergé dans leurs rangs. Dans le Brakna et le Gorgol, les Peulhs firent preuve d’une grande résilience. Des figures locales s’opposèrent fermement aux tentatives françaises de domination, de réquisition et d’implantation de l’administration. Certaines familles nobles, telles que les Ehel Wane, refusèrent la collaboration et préférèrent l’exil ou la lutte.
La résistance peulhe s’inscrivait aussi dans un cadre religieux. Nombre d’entre eux furent influencés par les idéaux réformistes des courants tidjaniens ou hamallistes, qui rejetaient la domination des infidèles et prônaient un retour à une société musulmane autonome et juste. Les Peulhs s’allièrent parfois avec d’autres communautés résistantes, notamment les Soninkés du Guidimakha ou les Maures du Tagant, pour repousser l’envahisseur. Dans certaines zones, ils fournirent nourriture, cachettes ou soutien logistique aux combattants.
La répression coloniale fut brutale. De nombreux chefs peulhs furent arrêtés, envoyés en exil vers l’Afrique occidentale française – notamment Dakar, le Bénin ou Atar – ou déportés avec leurs familles. La dislocation des structures sociales traditionnelles et la sédentarisation forcée affectèrent durablement leur mode de vie. Dans plusieurs cas, les villages furent rasés ou déplacés pour couper court à toute forme de résistance.
Aujourd’hui, des historiens et des acteurs de la société civile plaident pour une relecture de l’histoire coloniale en Mauritanie, plus inclusive et plus fidèle à la diversité des résistances. Des villages comme Wagadu, Djeol, Touldé ou Sélibaby conservent encore des traces de cette époque troublée. Des noms de martyrs oubliés attendent d’être réhabilités. Redonner une place à la mémoire peulhe dans le récit national, c’est reconnaître que la Mauritanie s’est construite grâce à la bravoure de toutes ses communautés, unies par la douleur et l’honneur de la résistance.
Mohamed BNEIJARA