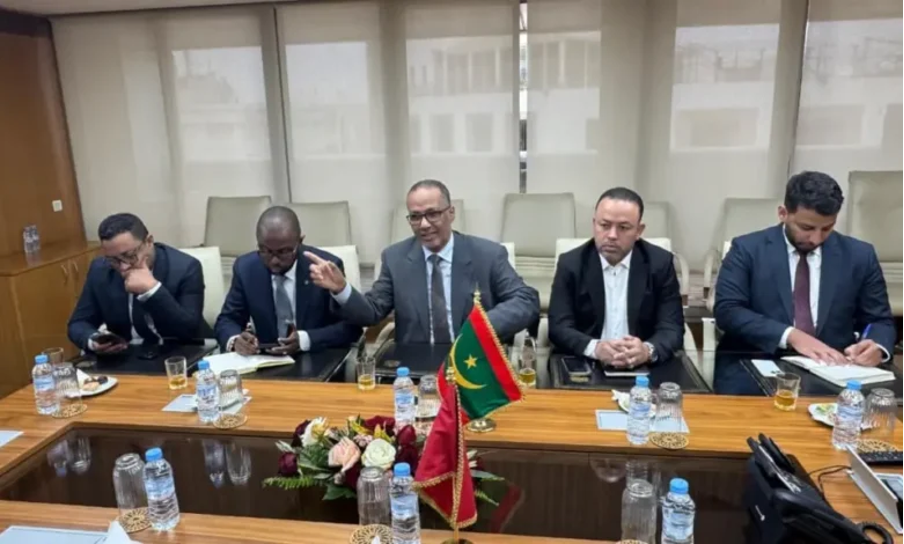La Mauritanie traverse une période critique où se multiplient les signaux d’alarme. L’impression dominante est celle d’un pays qui avance à l’aveuglette, sans prendre les mesures nécessaires pour réguler ou résoudre les causes profondes de ses fragilités. Et cette fois, ce ne sont plus seulement les voix de l’opposition qui s’élèvent : ce sont aussi des cris venant de l’intérieur même de la majorité. Des parlementaires issus du pouvoir commencent à dénoncer ouvertement l’indifférence de leur propre camp face à la gravité des menaces qui pèsent sur la nation.
Le constat est amer : comme l’a dit un jour Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République, « Mon engagement est celui d’une Mauritanie unie et inclusive, où chaque citoyen, sans distinction, doit avoir accès à une vie décente et pouvoir s’épanouir. Nous devons absolument éradiquer les séquelles de l’esclavage et combattre les disparités qui minent notre cohésion sociale. En mettant en place des politiques volontaristes, j’aspire à garantir à chacun les mêmes opportunités, en particulier à ceux qui sont les plus vulnérables. » Pourtant, ses discours et ses promesses, notamment lors de ses voyages à Ouadane ou à Djewol, n’ont pas été suivis de mesures concrètes et efficaces. La réalité montre plutôt une faiblesse des initiatives, un manque de résultats tangibles, et une extension d’un climat de division et de populisme qui ronge toutes les communautés, malgré l’investissement considérable de ressources financières dans les programmes publics.
Le tissu social, déjà fragile, est aujourd’hui exposé à des fractures plus profondes, alimentées par des discours ethniques désormais tolérés et banalisés. L’indifférence des acteurs politiques face à cette dérive frise parfois la complicité : au lieu de soutenir les orientations du Président, ils se réfugient dans une passivité inquiétante, qui peut parfois ressembler à du sabotage, de la trahison ou tout simplement à une incapacité à agir.
La religion, qui constitue le ciment moral et spirituel du pays, n’est pas épargnée. Elle se trouve fragilisée par la multiplication d’ateliers et de débats imposés autour des accords d’Abraham, qui sèment davantage de confusion et de division plutôt que de cohésion. Pendant ce temps, au lieu de défendre l’essentiel — la paix sociale, la solidarité nationale et la justice sociale —, les pouvoirs publics s’éparpillent dans des discussions stériles, des arrestations sélectives ou des convocations inutiles, en s’acharnant sur des individus pour des propos ou des positions exprimés, au lieu de se concentrer sur l’essentiel : élaborer des programmes productifs à forte intensité de main-d’œuvre pour lutter contre la pauvreté, assurer la sécurité alimentaire et réduire la malnutrition qui frappe encore durement nos populations.
Les défis de la Mauritanie ne s’arrêtent pas à ses frontières. Le pays est aujourd’hui soupçonné d’être un passage d’armes en direction des groupes jihadistes du Sahel. Par ailleurs, la visite du Rapporteur spécial des Nations unies sur les droits des réfugiés met la Mauritanie sous le regard attentif de la communauté internationale, soulignant la nécessité de respecter les droits fondamentaux, d’améliorer la protection des plus vulnérables et de renforcer l’inclusion.
Face à cette réalité, la répression n’est pas une solution. La fermeture du champ politique et social ne ferait qu’accroître la fragilité de la nation. Ce dont la Mauritanie a besoin, c’est de tolérance, de justice, de respect des droits des citoyens, et d’une mobilisation collective autour de projets porteurs. Les richesses du pays ne doivent pas devenir la source de malversations, mais un levier pour un développement équitable, capable de répondre aux aspirations d’un peuple fatigué d’attendre.
Le monde évolue rapidement, les crises se succèdent, et il est impensable de rester enfermés dans nos divisions, nos rivalités internes ou nos calculs politiciens mesquins. Le peuple mauritanien doit se rassembler, s’unir autour de l’essentiel, et refuser toute instrumentalisation politique, ethnique ou sectaire. Les signaux d’alarme sont là, visibles par tous. Si nous ne nous levons pas collectivement pour les éteindre, ils risquent de se transformer en incendies incontrôlables.
Mohamed BNEIJARA