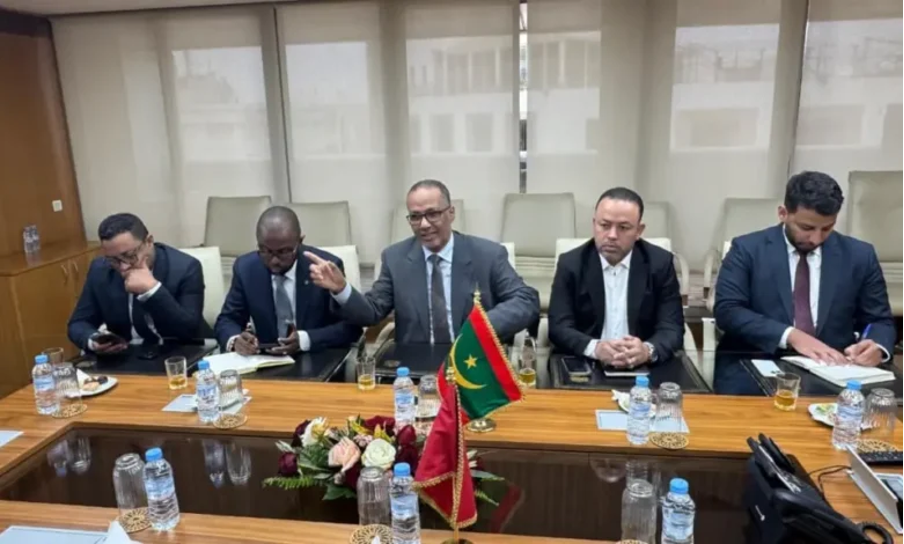La crise actuelle d’approvisionnement en eau potable que traverse la Mauritanie n’est ni le fruit du hasard ni une fatalité. Elle résulte d’une gestion laxiste, d’un manque de rigueur dans la commande publique et d’une absence de vision stratégique à long terme, qui continuent de compromettre des projets pourtant essentiels pour le pays.
Dans un contexte de stress hydrique croissant, la Mauritanie, pays désertique aux nappes phréatiques souvent peu profondes et salinisées, doit faire face à des défis majeurs. La stratégie nationale d’approvisionnement repose principalement sur les ressources du fleuve Sénégal. Si cette option paraît rationnelle, elle doit s’appuyer sur une capitalisation rigoureuse des expériences passées — or, cette étape est cruellement négligée.
Les réseaux de distribution d’eau sont aujourd’hui fortement dégradés : les pertes dépassent parfois 40 %, principalement à cause de fuites non maîtrisées et d’un réseau vieillissant. La situation est aggravée par une urbanisation anarchique, notamment en zones rurales et périurbaines, rendant difficile toute couverture efficace. Le cas de Sélibaby illustre à lui seul ces défaillances systémiques. Malgré un projet d’approvisionnement finalisé et transmis à la Société Nationale de Distribution d’Eau (SNDE), la population ne reçoit l’eau que tous les trois jours. La cause principale : une capacité de pompage insuffisante, alimentée par une machine asiatique peu performante. La SNDE doit alors rationner l’eau de manière contraignante, alors même que la machine a été fournie par un prestataire peu soucieux des enjeux liés à la commande publique et à l’intérêt général.
Aujourd’hui, la critique à l’encontre de la SNDE apparaît injuste : le dysfonctionnement résulte d’un projet mal conçu en amont. Il ne faut pas seulement blâmer l’opérateur, mais revoir l’ensemble du processus de planification et d’exécution des projets.
Alors que l’État envisage désormais d’étendre l’approvisionnement en eau depuis le fleuve vers une cinquantaine de villages, ainsi que vers Kiffa, située à près de 300 km, il est impératif de tirer les leçons des erreurs passées. Répéter les mêmes schémas, notamment dans le choix des équipements ou la sélection des prestataires, risque non seulement de compromettre la réussite des futurs projets, mais aussi d’entacher durablement l’image de l’État et de ses institutions techniques.
L’eau, ressource vitale, ne peut reposer sur un seul réseau d’approvisionnement. Chaque grande ville doit disposer de plusieurs alternatives — plans A, B, voire C — pour faire face aux fluctuations saisonnières, aux besoins croissants ou aux pannes imprévues. La réhabilitation des anciens forages, aujourd’hui souvent abandonnés, doit devenir une priorité : ils doivent être équipés de réserves et intégrés aux systèmes de secours pour garantir la continuité de l’approvisionnement.
Par ailleurs, l’État doit envisager des solutions de long terme, telles que la désalinisation de l’eau de mer, bien que coûteuse. Dans un pays soumis à des aléas climatiques, à une urbanisation rapide et à une croissance démographique soutenue, disposer d’une source d’eau fiable, même onéreuse, pourrait prévenir une catastrophe humanitaire en cas de pénurie aiguë.
Enfin, la gouvernance de l’eau doit faire l’objet d’une refonte profonde. Il ne s’agit plus seulement de réagir à la crise, mais d’anticiper les besoins futurs en adoptant une vision stratégique, pragmatique, durable et inclusive. La gestion intégrée des ressources en eau doit devenir une priorité nationale, mobilisant tous les acteurs — gouvernement, sociétés civiles, partenaires internationaux — autour d’un plan global à la hauteur des enjeux vitaux que représente l’accès à l’eau pour la Mauritanie.
Mohamed BNEIJARA