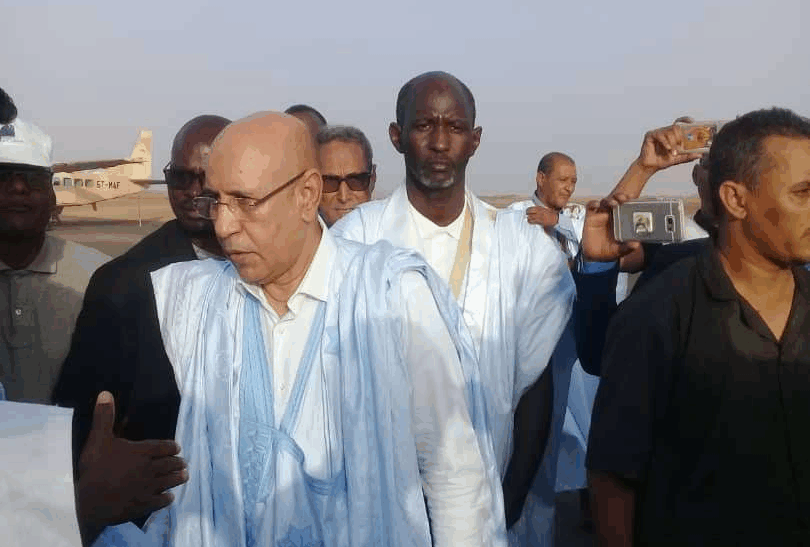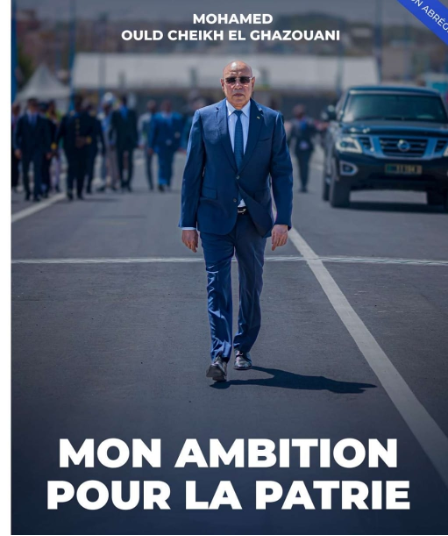Dans un pays à la mosaïque identitaire aussi complexe que la Mauritanie, la diversité culturelle et ethnique devrait être une force, une richesse partagée, un socle pour construire une nation unie et solidaire. Pourtant, cette richesse se transforme parfois en ligne de fracture, fragilisant le tissu social et menaçant la paix civile. Depuis plusieurs semaines, des propos et comportements à forte connotation ethnique se répandent dans l’espace public, notamment sur les réseaux sociaux, ravivant des tensions que l’on croyait apaisées. Ce climat délétère inquiète nombre de citoyens, d’acteurs politiques et de membres de la société civile, qui voient là un risque de dérive communautariste aux conséquences potentiellement graves.
La Constitution mauritanienne est pourtant claire. Elle consacre la Mauritanie comme une République islamique, démocratique, sociale et indivisible. Elle garantit à tous les citoyens, sans distinction d’origine, de race, de sexe ou de condition sociale, l’égalité devant la loi. En vertu de ces principes fondamentaux, aucun citoyen ne devrait se sentir marginalisé ou menacé en raison de son appartenance ethnique. Pourtant, dans la réalité quotidienne, certains discours véhiculent l’exact contraire : ils divisent, opposent, attisent les rancœurs et remettent en cause le principe d’unité nationale. Cette dynamique est non seulement dangereuse, mais contraire aux lois en vigueur.
Le droit mauritanien prévoit en effet des dispositions précises pour lutter contre ces dérives. Le Code pénal criminalise tout appel à la haine, à la discrimination ou à la violence fondée sur la race ou l’ethnie. Des peines sont prévues pour toute personne ou groupe qui incite publiquement à des discours de haine ou s’adonne à des pratiques discriminatoires. Ces textes doivent aujourd’hui être appliqués avec rigueur, sans faiblesse ni hésitation, car il en va de la stabilité du pays et du respect des valeurs républicaines. La justice a un rôle central à jouer, mais elle doit être appuyée par une volonté politique forte et constante.
Il est du devoir des autorités de prendre la mesure du danger et de réagir avec fermeté. Face à l’expansion des discours haineux, notamment dans le monde numérique où les propos les plus extrêmes circulent rapidement et touchent un large public, l’État ne peut se contenter d’observer. Il lui incombe de surveiller, de prévenir et, si nécessaire, de sanctionner avec impartialité et célérité. Cette vigilance ne doit pas être perçue comme une censure, mais comme une exigence de préservation du vivre-ensemble et de l’ordre public.
Mais au-delà des institutions étatiques, cette lutte est l’affaire de tous. La responsabilité est collective. Les chefs religieux, les leaders traditionnels, les enseignants, les journalistes, les artistes, les organisations de jeunesse, les ONG, les partis politiques – chacun, à son niveau, doit promouvoir une culture de tolérance, de respect mutuel et de dialogue. Il ne suffit pas de condamner les discours haineux après coup : il faut aussi, et surtout, agir en amont, en construisant une narration inclusive qui valorise la diversité nationale comme un atout, et non comme une menace.
L’histoire de la Mauritanie est marquée par des périodes de tensions identitaires, mais aussi par des moments de solidarité et de convergence entre les différentes composantes du pays. Il est impératif de se souvenir de cette histoire pour éviter d’en répéter les erreurs. La jeunesse, en particulier, mérite mieux qu’un climat de suspicion ou de repli identitaire. Elle mérite un avenir où elle peut grandir et s’épanouir sans être enfermée dans des appartenances figées. Elle mérite un pays qui croit en la justice, en l’égalité, et en la fraternité entre tous ses enfants.
Face aux dangers de la division, il est temps de réaffirmer haut et fort que la Mauritanie est une et indivisible. Que ses citoyens, quelles que soient leurs origines, doivent se sentir protégés, respectés et considérés. La paix sociale, comme la démocratie, n’est jamais acquise. Elle se construit chaque jour, par des actes concrets, une parole responsable, une gouvernance équitable. Et cette construction commence par un refus clair et sans équivoque de toute forme de haine ou de stigmatisation. Il est encore temps d’agir, collectivement et résolument, pour que la diversité mauritanienne continue d’être une chance, et non un péril.
Mohamed BNEIJARA