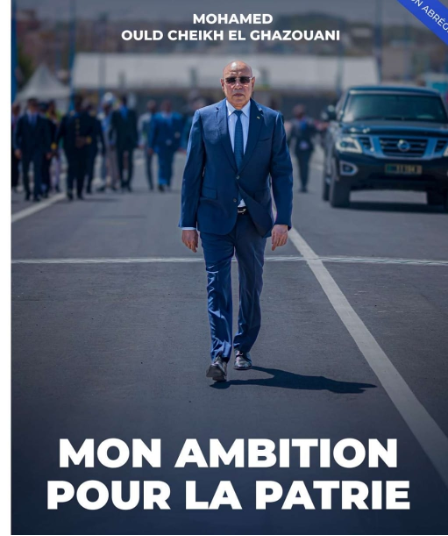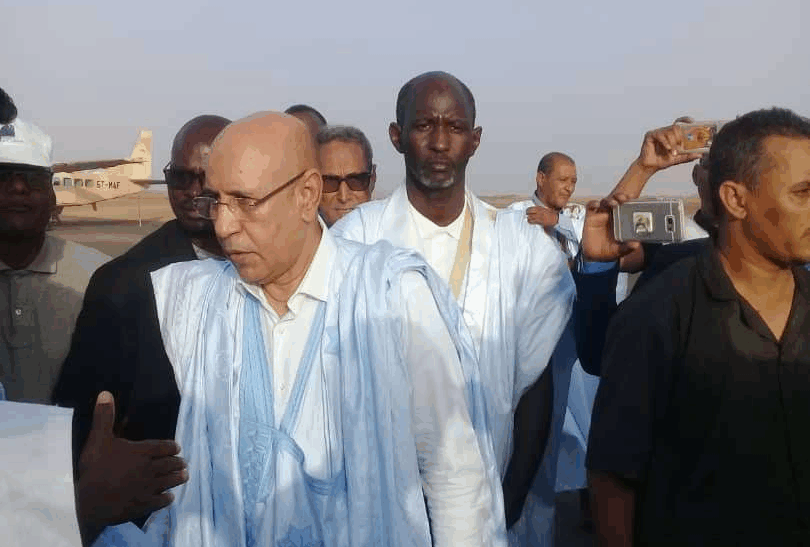La Mauritanie se définit dans sa Constitution comme une république islamique, indivisible, démocratique et sociale. Elle garantit à tous ses citoyens, sans distinction d’origine, de race, de sexe ou de condition, l’égalité devant la loi. Pourtant, dans les faits, les fractures identitaires, tribales, sociales et culturelles restent bien ancrées dans le quotidien. Et au lieu de les dépasser, nous les avons trop souvent instrumentalisées.
Dans cette Nouvelle Mauritanie que nous appelons de nos vœux, il ne peut y avoir de place pour une organisation sociale fragmentée entre tribus, chefs traditionnels, confréries religieuses et solidarités claniques. Ce monde ancien, sclérosé, continue pourtant de dominer nos esprits, nos institutions et même nos écoles. L’État, lui, reste spectateur, passif, alors que nos références culturelles et religieuses se transforment sous nos yeux, sans boussole morale commune ni autorité spirituelle partagée pour rappeler l’exigence de justice.
Notre société est aujourd’hui traversée par une crise identitaire profonde, renforcée par des pratiques culturelles devenues spectacles, vidées de leur sens. Il ne suffit plus de chanter la diversité lors de festivals ou de hisser des tissus colorés en guise de « vivre ensemble ». Car pendant que des pirogues pleines de tiktokteuses hyper-maquillées d’une seule communauté voguent vers l’exotisme sponsorisé, c’est l’image d’une culture nationale inclusive qui chavire. La culture devient vitrine, vitrine qui exclut, vitrine qui divise.
Non, la mission d’un département de la culture ne peut se limiter à l’organisation de festivals. Ceux-ci ne sont que des outils, pas une finalité. Une politique culturelle digne de ce nom doit viser à bâtir un socle commun, réconcilier les héritages, valoriser les diversités et impulser un projet collectif.
Voici ce que devrait être la mission réelle et profonde d’un département de la culture :
- Préserver notre patrimoine commun, matériel et immatériel : des manuscrits aux contes oraux, des langues nationales aux danses anciennes, des sites historiques aux savoir-faire traditionnels.
- Soutenir la création artistique, dans toutes ses formes, en encourageant les jeunes talents et en facilitant l’accès aux moyens de production et de diffusion.
- Développer les infrastructures culturelles dans tout le pays : bibliothèques, centres culturels, musées, salles de spectacle accessibles à tous, y compris dans les zones rurales et marginalisées.
- Intégrer la culture dans l’éducation, pour former des citoyens ouverts, tolérants, conscients de leurs racines et capables de dialoguer avec le monde.
- Encourager les industries culturelles, véritables leviers économiques pour la jeunesse, l’emploi, l’innovation et la valorisation des savoirs locaux.
- Renforcer la coopération culturelle, aux niveaux national et international, pour inscrire la Mauritanie dans les échanges du monde contemporain sans renier son âme.
- Garantir les droits culturels, c’est-à-dire le droit pour chaque citoyen de participer à la vie culturelle, de s’y exprimer, d’y créer et d’y transmettre.
Si la culture est reléguée au folklore ou à l’ethnicisme déguisé, elle devient un facteur de division. Mais si elle est pensée comme une politique publique transversale, ambitieuse, inclusive, alors elle devient un ciment puissant. Un outil de développement humain. Un moteur de réconciliation. Un miroir où chaque Mauritanien, qu’il soit de Mbout ou de Zouerate, d’Oualata ou de Tevragh-Zeina, peut se reconnaître.
La mission culturelle de l’État ne peut être laissée aux réseaux sociaux, aux marchands de buzz ou aux nostalgies féodales. Elle doit être portée par une vision républicaine exigeante, rigoureuse, profondément égalitaire.
Il est temps que l’État mauritanien prenne toute la mesure de ce chantier. L’égalité devant la loi, l’accès équitable aux ressources, la promotion de toutes les cultures nationales, sans hiérarchie ni exclusion, doivent devenir la norme. Non seulement dans les discours, mais dans les faits.
C’est à ce prix que la culture cessera d’être un miroir déformant pour devenir un véritable outil de transformation sociale.
Mohamed BNEIJARA