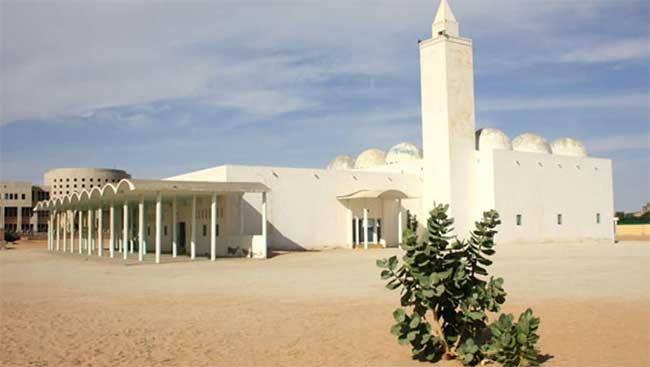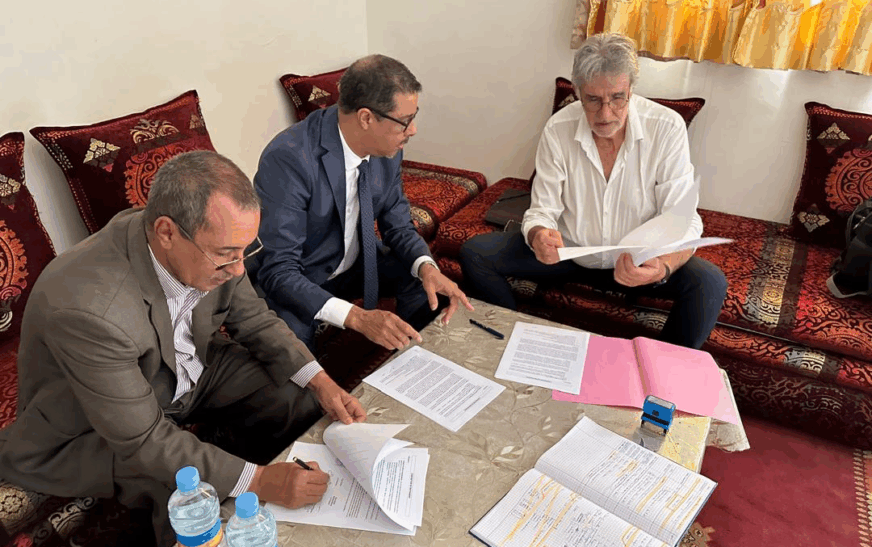Ce lundi, les autorités mauritaniennes ont lancé à Nouakchott une campagne nationale contre la mendicité. Portée par le Programme national de lutte contre la mendicité, sous l’égide du ministère de l’Intérieur, l’opération vise à retirer les mendiants des rues de la capitale, à leur proposer des alternatives concrètes et à restaurer l’ordre dans l’espace public. Une initiative saluée par beaucoup, tant la prolifération de la mendicité était devenue choquante. Mais la vraie question demeure : s’agit-il d’un simple « coup de balai » conjoncturel ou d’un tournant structurel vers une société plus juste ?
La stratégie annoncée est ambitieuse sur le papier. Elle repose sur quatre piliers : le recensement des mendiants dans une base de données, la mise à disposition d’abris temporaires, l’orientation vers des projets générateurs de revenus, et un plan de communication pour sensibiliser la population. Dès les premières heures, plusieurs dizaines de personnes ont été prises en charge et informées des alternatives existantes. On peut difficilement contester l’utilité immédiate d’une telle mesure.
Mais la lutte contre la mendicité n’est pas qu’une question d’ordre public ou d’esthétique urbaine. C’est d’abord une affaire de justice sociale. Derrière chaque main tendue se cachent des réalités complexes : pauvreté structurelle, absence de protection sociale, migrations forcées, trafics d’êtres humains parfois, et surtout l’abandon de franges entières de notre population par les politiques publiques. C’est pourquoi il est essentiel que cette campagne ne s’arrête pas à la surface des choses.
La question de la durabilité est cruciale. Avons-nous les moyens de mettre en œuvre des programmes d’insertion professionnelle sérieux, avec des formations adaptées, des crédits d’amorçage, un suivi social ? Les abris préparés pour accueillir les mendiants deviendront-ils de simples entrepôts d’exclusion ou des tremplins vers une réintégration digne ? Une base de données vivante suppose un personnel qualifié et une volonté constante de suivi : en avons-nous la capacité institutionnelle ? Et surtout : briserons-nous le cercle vicieux entretenu par les dons à la sauvette et parfois les réseaux organisés de mendicité ?
Dans un pays musulman qui compte moins de 5 millions d’habitants, il est inadmissible que des milliers de personnes survivent dans la rue, exposées aux intempéries, aux violences, et parfois à l’instrumentalisation religieuse ou mafieuse. Si cette campagne est le premier pas vers une politique nationale de solidarité, articulée autour de la dignité humaine et de l’inclusion sociale, alors c’est un tournant que nous devons encourager, soutenir, et surveiller.
Mais si, comme tant d’initiatives avant elle, elle n’est qu’un effet d’annonce de plus, motivée par la pression sociale, médiatique ou diplomatique, alors nous aurons simplement repoussé le problème de quelques jours… avant qu’il ne réapparaisse, aggravé, sous une autre forme.
L’éradication de la mendicité ne peut être un réflexe sécuritaire. Elle doit devenir une ambition sociale et un objectif politique clair, transversal, permanent. C’est à ce prix seulement que la Mauritanie pourra prétendre à une société plus équitable, à la hauteur des valeurs islamiques qu’elle revendique, et d’une image de pays digne, responsable et tourné vers l’avenir.
Mohamed BNEIJARA