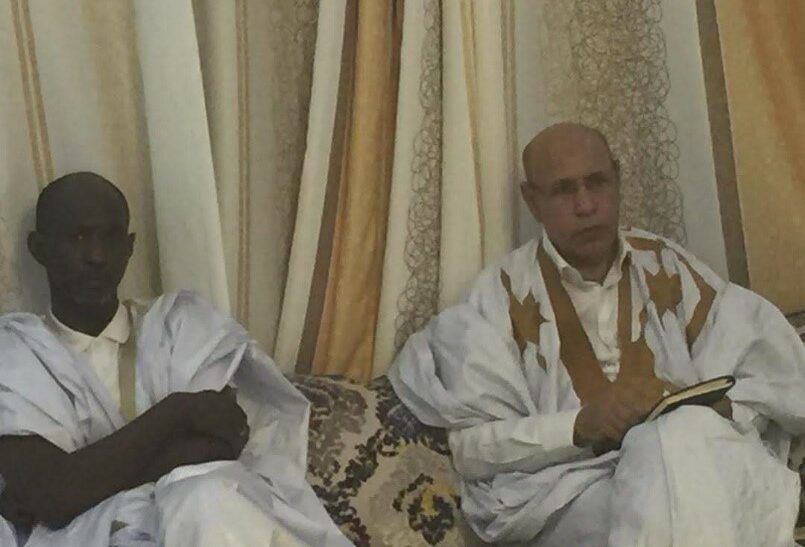Il est étonnant, voire préoccupant, de constater que c’est le président de la République lui-même qui doit ordonner l’affectation d’interprètes accrédités dans toutes les langues nationales au sein des tribunaux. Une mesure pourtant évidente et relevant des prérogatives du ministère en charge de la Justice. Ce dernier aurait dû depuis longtemps répondre à ce besoin élémentaire, essentiel au bon fonctionnement d’un système judiciaire équitable et inclusif.
Nous vivons une époque étrange, où l’on célèbre des actes qui devraient relever de la simple normalité. La gendarmerie mène une enquête ? Bravo ! Les services de santé effectuent une opération chirurgicale ? Félicitations ! Les douaniers saisissent de la contrebande ? Quelle prouesse ! Un député défend son parti, un parti organise une campagne de sensibilisation… Chaque action, chaque devoir accompli semble désormais donner lieu à une ovation. Une forme perverse de corruption symbolique est en train de s’installer : celle qui consiste à applaudir les agents de l’État pour l’accomplissement de leurs missions, pourtant rémunérées, encadrées et attendues.
Cela témoigne surtout d’un malaise plus profond : les fonctionnaires ne disposent plus des moyens ni des conditions dignes de la mission qui leur est confiée. Servir l’administration générale n’a jamais été aussi peu attractif. Si les salaires n’ont jamais rivalisé avec ceux du secteur privé, les compensations symboliques – logements de fonction, véhicules de service, reconnaissance sociale – permettaient de maintenir une certaine fierté dans la fonction. Malheureusement, ces avantages disparaissent peu à peu.
Face à ce déclin, l’État semble préférer multiplier les louanges au lieu de garantir des conditions de travail adéquates et d’exiger un service public de qualité, dans la discrétion et la rigueur. Car le service public ne devrait pas être une vitrine de vanité, mais une vocation nourrie par l’engagement, la compétence et le devoir.
Mohamed BNEIJARA